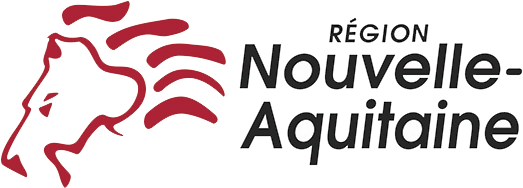À 15h18, le 3 juin 1991 à Kyushu au Japon, un tsunami de cendres et de roches incandescentes dévale à plus de 500 km/h les pentes du Mont Unzen, détruisant tout sur son passage. Quarante-trois personnes sont tuées sur le coup. Parmi les morts, les deux volcanologues français, mythiques, parfois mystiques, emportés par le feu sacré qui les animait – et leur caméra avec eux. Une histoire de cinéma qui semble faite pour Werner Herzog, dont l’œuvre est traversée par des personnages courant au-devant de la catastrophe : d’Aguirre la colère de Dieu jusqu’à Bad Lieutenant, il y a toujours un cataclysme à l’œuvre chez le cinéaste qui a filmé l’homme qui a vu l’ours et en est mort.
Katia et Maurice Krafft, dont on finit par ne plus trop savoir s’ils étaient d’illustres scientifiques, de dangereux casse-cous pyrophiles ou de magnifiques pionniers du cinéma à leur insu, laissent derrière eux une œuvre filmée époustouflante : Werner Herzog puise avec allégresse dans les archives foisonnantes du couple pour célébrer avec force et poésie les deux chercheurs qui auront passé l’essentiel de leur vie à danser et (se) filmer sur les volcans. Son film incandescent redonne vie à des images flamboyantes qui documentent 25 ans de passion éruptive, de l’Eldfell en 1973 à ce triste jour de juin 1991 en passant par le mont Saint Helens en 1980, le Nevado del Ruizen en 1985… Une formidable somme d’images d’une beauté stupéfiante, Maurice avec sa caméra, Katia avec son appareil photo.
Werner Herzog, passionné lui-même par les Krafft et les volcans (il n’y a pas de fumée sans feu), use de son sens de la narration et de son goût pour le sublime – voire le grandiloquent – pour rendre hommage à ces deux grands scientifiques qui ont tant de fois trompé la mort et défié les éléments. Au-delà des éruptions, le cinéaste semble captivé par la manière dont les Krafft se sont mis en scène, l’imagerie déployée et la singularité de leur regard. D’abord touristes ordinaires, les Krafft ont appris au fil des expéditions à saisir et affiner leur sujet. Lors de leurs premiers tournages, ils recourent à des mises en scène maladroites, espérant donner à voir le spectaculaire en plaçant l’humain au centre du cadre pour restituer l’échelle des phénomènes filmés. Puis progressivement le cadre se resserre, jusqu’à de stupéfiantes séquences filmées par Maurice au plus près des éruptions : d’hypnotiques symphonies de couleurs tendant vers l’abstraction, des jaillissements de lave rouge en plan serré, des paysages désolés parcourus de fumerolles d’où surgit la petite silhouette blanche de Katia s’avançant au bord du gouffre. Au cœur des volcans révèle aussi le regard profondément humaniste de ces passeurs de science qui, en se penchant sur le sort des victimes des éruptions, ont sensibilisé le monde entier à la prévention des risques volcaniques.
D'après Utopia
au mardi 14 janvier
au mardi 21 janvier