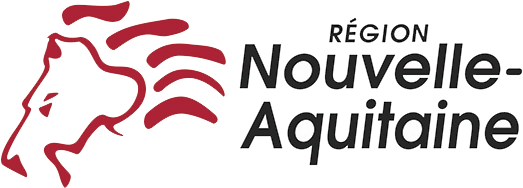Voilà un film magnifique dont la construction en trois parties, qui pourrait paraître artificielle, fait grimper l’émotion avec une rare intelligence, pour vous laisser à la fin du troisième volet lessivé, face au destin tragique et méconnu d’un peuple. Ici, loin de tout manichéisme, femmes et hommes sont unis pour le meilleur et pour le pire, alors que seul l’amour que chacun porte à ses proches les préserve de la tristesse infinie. Le « Pays de nos frères » du titre évoque le nom donné par les Afghans candidats à l’exil à l’Iran, le pays voisin, avec qui ils partagent souvent langue et culture et qui, en près de 40 ans de guerre, a accueilli pas loin de 5 millions d’entre eux. Car, contrairement aux préjugés, l’Iran est resté la principale terre d’exil et d’asile des Afghans. Un titre poétique pour évoquer une réalité sociale et politique qui l’est beaucoup moins.
Le film déroule sur vingt ans – et en trois parties donc (2001, 2011, 2021), depuis les lendemains des attentats du 11 septembre et la guerre menée par les États Unis à leurs auteurs, jusqu’à la période du COVID et de la guerre menée en Syrie à Daesh – le destin de protagonistes afghans tour à tour personnages principaux et secondaires.
Le premier volet s’articule autour de Mohammad, un lycéen qui subit le harcèlement d’un policier iranien, lequel le réquisitionne pour ranger des archives dans un sous-sol inondé, avant de s’intéresser à l’adolescent pour de bien plus inavouables raisons. Mohammad est secrètement amoureux de Leila, avec qui il vit au cœur des montagnes dans une ferme horticole qui rassemblent de nombreux ouvriers agricoles afghans surexploités. Malheureusement, Quasem, le frère aîné de Leila, a déjà arrangé son mariage.
Dix ans plus tard, Leila est devenue auprès de son mari employée de maison d’une riche famille dans une villa en bord de mer. Lorsque, situation tragique et ubuesque, son mari meurt subitement, elle tente de cacher le décès par crainte de l’expulsion pour elle et son enfant.
En 2021 enfin, on retrouve Qasem, convoqué par le bureau de l’immigration où un fonctionnaire lui apprend la mort de son fils – qu’il croyait émigré en Turquie et qui avait en fait rejoint les forces iraniennes combattantes en Syrie…
Tout en finesse, les deux réalisateurs – désormais également exilés (l’une à New York, l’autre à Paris) – évoquent en trois temps les marques plus ou moins cruelles du destin des immigrés : l’exploitation économique, la répression arbitraire par les forces de police, l’utilisation des nouveaux arrivants dans des guerres qui ne les concernent pas. Autant d’aspects de l’émigration qui ne sont pas spécifiques à l’Iran et font l’universalité du film – on pense aux Subsahariens esclaves dans les maraîchages du Sud de l’Europe, aux employés de maison de nos grandes familles ou aux malheureux candidats à l’immigration aux États-Unis qui gagnent leur naturalisation en partant guerroyer à l’autre bout du monde…
À travers des récits magistralement simples, qui ont le brio discret des films du regretté Abbas Kiarostami, on est saisi par la magnifique et implacable description du silence, du secret et de la peur intériorisés par les trois protagonistes. Il faut également souligner la performance remarquable de Hamideh Jafari dans le rôle de Leila, seul personnage qui traverse l’intégralité du film.
D'après Utopia