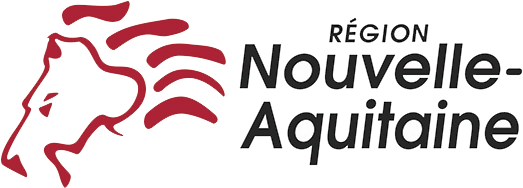À Yaoundé, le commissaire Billong enquête sur le meurtre d’un officier de police. Dans la rue comme au sein de sa famille, il peine à maintenir l’ordre. Homme de principe et de tradition, il approche du point de rupture.
Le titre du premier long-métrage de Thomas Ngijol ne renvoie pas tant à son cadre, ce Cameroun qu’on pourrait croire naturellement plongé dans une anarchie latente en raison de son passé. Le pluriel fait toutefois sens : les vrais indomptables, ce sont les hommes qui définissent les règles, ceux-là mêmes qui semblent promis au maintien de l’ordre et à assurer la pérennité du pays. Le meurtre d’un officier de police, servant de point de départ au film, n’est qu’un prétexte pour mettre en lumière les problématiques sociales émergeant indéniablement dans un pays privé de son bon développement.
Le cinéaste-comédien souhaitait éviter tout misérabilisme en prenant son pays d’origine pour décor, la chose est assurément réalisée avec la sincérité de montrer l’ensemble sans manichéisme. Cette enquête menée par le commissaire Billong (Thomas Ngijol) cristallise l’ambivalence de nos regards sur ce que la caméra pointe méthodiquement : il n’y a jamais de « camps » à proprement parler dans Indomptables, la police, la famille, la criminalité, il ne s’agit que d’entités informes partageant les mêmes problèmes, ceux d’un peuple dans l’impasse.
État à l’indépendance relativement récente, le Cameroun s’est vu spolié de ses ressources les plus précieuses par des nations « tutrices », ses anciennes puissances colonisatrices. En reste depuis les années 1960, un pays profondément marqué par des mesures répressives strictes et souvent arbitraires. Un régime colonial qui s’est faussement rétracté du pays, ne le laissant jamais hors de son girond. Avec Indomptables, le résultat de décennies d’exploitation sans réinvestissement direct se ressent, le Cameroun dépeint dans le film est avant tout la somme de ce qu’on lui a volé. La police de Yaoundé pourchasse les criminels, mais ces voleurs de bétail ou de vêtements paraissent bien inoffensifs en comparaison des institutions véreuses, fruits d’une société paralysée par des nations rapaces.
Il est donc quelque part question d’héritage dans Indomptables. Plusieurs fois, l’accent est mis sur les générations précédentes, ce père qui a combattu dans les maquis pour l’indépendance, ces traditions qui forment les principes du protagoniste, mais aussi le nom de sa propre mère, synonyme d’une certaine fierté généalogique. Le modèle de droiture du personnage de Thomas Ngijol repose sur ce culte de l’ancien, aussi bien dans ses méthodes de policier à la limite de l’éthique que dans son rôle de père assumant sa sévérité. L’homme se confond, se perd entre les interrogatoires musclés, autels de violences exacerbées, et son propre toit, sous lequel il verrait presque en ses fils des ennemis à l’encontre de ses valeurs. Mais les valeurs et les principes sont justement en pleine tempête, dans un Cameroun où même prendre la route s’avère laborieux. La sensibilité de l’homme se dévoile en même temps qu’éclos une certaine amertume pour ce que devient son pays. L’origine de cette débâcle nationale s’incarne en un fond de Marvin Gaye lors d’une balade nocturne rappelant presque les grandes rues de Los Angeles, ou lorsque le commissaire s’indigne des méthodes de la police scientifique locale, jusqu’à la télévision, où certaines émissions reprennent des concepts bien connus ailleurs.
C’est l’influence – sous toutes ses formes – du monde occidental qui a créé et continue d’entretenir ce climat social inégal. Les tensions intérieures ne sont pas récentes sans pouvoir toutefois être totalement colmatées. Le commissaire Billong ne peut que contempler la suite d’un pays pour lequel ses aïeuls se sont battus, mais sa perdition traduit un doute immense : pouvons-nous seulement lutter sans endosser le rôle de nouveaux bourreaux ?
Le bleu du miroir