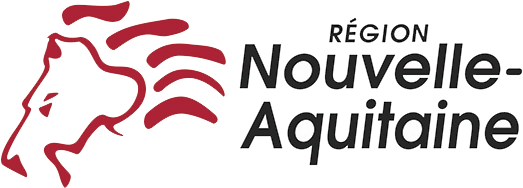À dix-sept ans, c’est de sa professeure de français que Johanne tombe amoureuse pour la première fois de sa vie. À cet âge, les sentiments sont de violentes tempêtes émotionnelles, d’autant plus lorsqu’ils se doublent de circonstances qui ont tout pour susciter les jugements : la différence d’âge, l’homosexualité, la relation d’autorité… Bien heureusement, Johanne se montre forte et, grande lectrice, trouve spontanément le moyen d’affronter la situation par l’écriture. Consciente du caractère intense et précieux de ce qu’elle est en train de vivre, elle consigne les sentiments qu’elle éprouve dans un carnet : « pour ne jamais oublier », comme elle dit.
Toute l’intelligence du film est de se servir de ces écrits pour créer une double temporalité : une pour la passion vécue par Johanne et une pour le récit qu’elle en fait. Autrement dit, ces notes deviennent à la fois le témoin d’instants véritables, racontés avec une grande précision par les mots d’une adolescente, et elles deviennent aussi l’objet intermédiaire qui lui permettra, à elle et à son entourage, de comprendre ce qu’elle a vécu. Car Johanne décide vite de donner son manuscrit, dans un premier temps à sa grand-mère, elle-même poétesse, qui en saisit la qualité littéraire et l’incite à le publier ; puis à sa mère, davantage préoccupée par ce que sa fille a vécu, qui questionne les sentiments qu’elle éprouve.
La lecture partagée de ce manuscrit provoque alors de subtiles répercussions que le film excelle à ramifier : mère et grand-mère projetant dans cette histoire leurs propres histoires, leurs propres désirs et toutes les trois confrontant leurs différentes visions de l’amour. Quelque part entre art et intimité, Rêves fait le récit d’une bouleversante éducation sentimentale, intergénérationnelle et résolument féminine.
Utopia